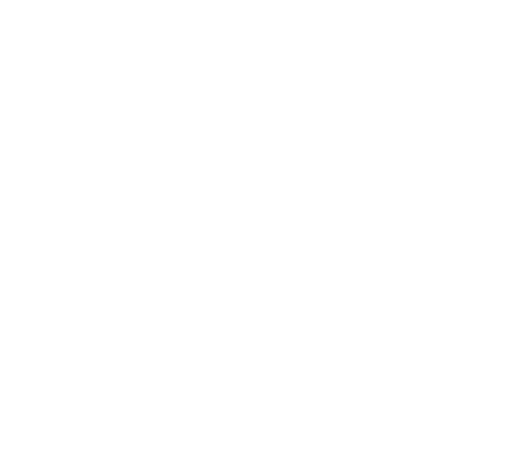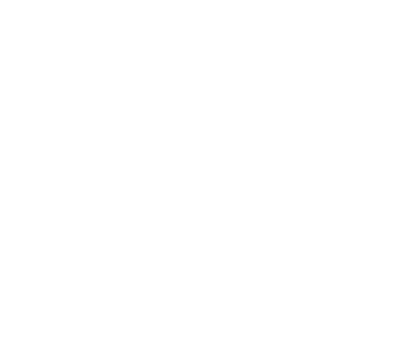Newsletter
Une fois par mois, recevez nos dernières actualités directement dans votre boîte mail.
Abonnez-vous ici >PFAS, métaux lourds, pesticides… Impossible d’échapper aux pollutions en Wallonie. À quel point cela nous impacte-t-il ? Réponse avec le monitoring de l’ISSeP.

Avec plus de 1700 participant·es et 80 substances analysées, le Biomonitoring humain Wallon dresse un portrait de l’état de santé des Wallon·nes face aux pollutions environnementales. Alors à quel point est-on exposé en Wallonie ? On jette un œil aux résultats de cette étude menée par l’ISSeP (Institut scientifique de service public).
Un biomonitoring humain est une façon de mesurer la quantité de substances dans le corps humain (sang, urine, cheveux…) pour avoir une idée de l’exposition moyenne des individus à ces substances. Ça permet aux institutions d’évaluer et de surveiller l’exposition des populations aux substances présentes dans l’environnement (intérieur ou extérieur). On peut aussi mieux comprendre ce qui favorise l’exposition (lieu de résidence, âge, sexe…).
Parmi les 80 substances étudiées, on trouve des catégories aux noms plus ou moins connus du grand public comme[1] :
Ce sont toutes des substances chimiques ou des polluants présents dans l’environnement qui peuvent avoir (ou sont suspectés d’avoir) des effets néfastes sur la santé humaine.
Des politiques de sensibilisation, de restriction ou d’interdiction de certaines substances ont été mises en place au niveau belge et/ou européen. Et leur effet est directement visible dans les analyses des Wallon·nes ! C’est l’un des grands enseignements de ce biomonitoring : pour les substances concernées par des législations, on constate une réduction des concentrations en polluants dans le corps[2].
On le voit par exemple pour :
Le rapport précise toutefois que ça ne suffit pas à éliminer totalement l’exposition. C’est normal puisque certaines de ces substances sont très peu biodégradables, persistantes et donc présentes sur un temps long dans l’environnement et les organismes vivants.
On attend avec impatience la suite du projet de biomonitoring. Les résultat de la phase 4 devraient arriver rapidement et aider à comprendre ce qui peut influencer l’exposition : type d’environnement, de comportement, facteurs socio-économiques…
En attendant, que faire concrètement pour diminuer son exposition aux polluants ?
Bref, il est impossible d’éviter tous les polluants mais on peut se renseigner sur les bons gestes pour réduire son exposition, en attendant que les politiques européennes et belges légifèrent plus fortement et sur plus de substances.
Les informations complètes sur le projet du Biomonitoring Wallon se trouvent sur le site de l’ISSeP.
[1] « Biomonitoring humain wallon. Détermination des valeurs de référence d’exposition pour la population wallonne - Résumé » ISSEP (2025)
[2] Réduction par rapport aux études antérieures sur des populations similaires ou vis-à-vis de pays ayant légiféré plus tardivement, même si cela peut prendre quelques années pour voir les effets.
Une fois par mois, recevez nos dernières actualités directement dans votre boîte mail.
Abonnez-vous ici >